
Explorer l’écriture comme une pratique artistique
Je propose des ateliers et des stages d’écriture à celles et ceux
qui souhaitent approfondir leur pratique,
en envisageant l’écriture comme un travail artistique exigeant,
ouvert à l’expérimentation
et au dialogue avec la littérature.
Porté par mon expérience artistique et universitaire,
mon travail s’inscrit dans une recherche continue
sur les formes, la langue et les processus de création,
avec une attention constante portée à la singularité de chaque écriture.
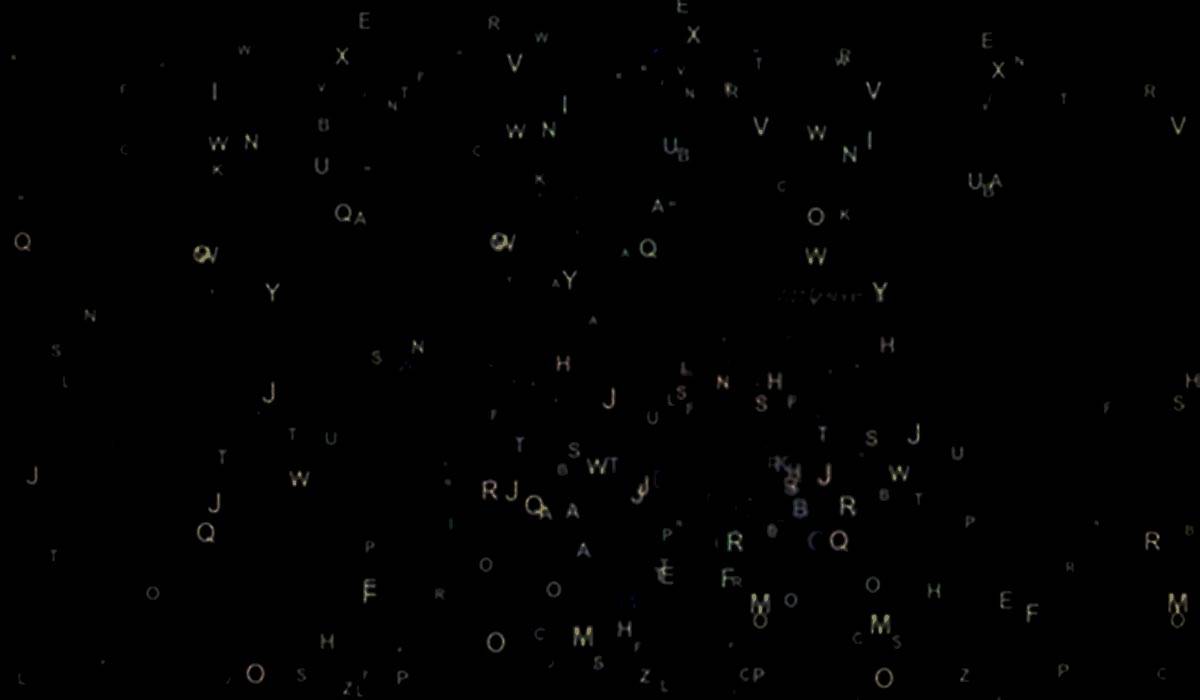

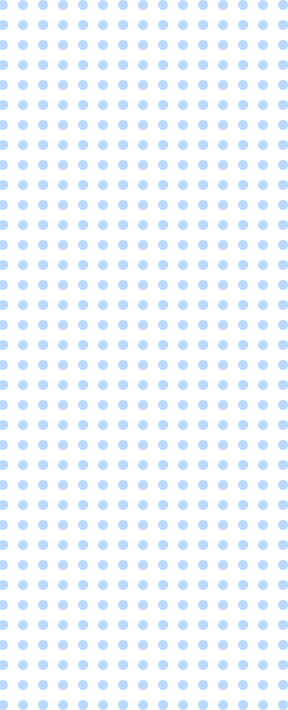
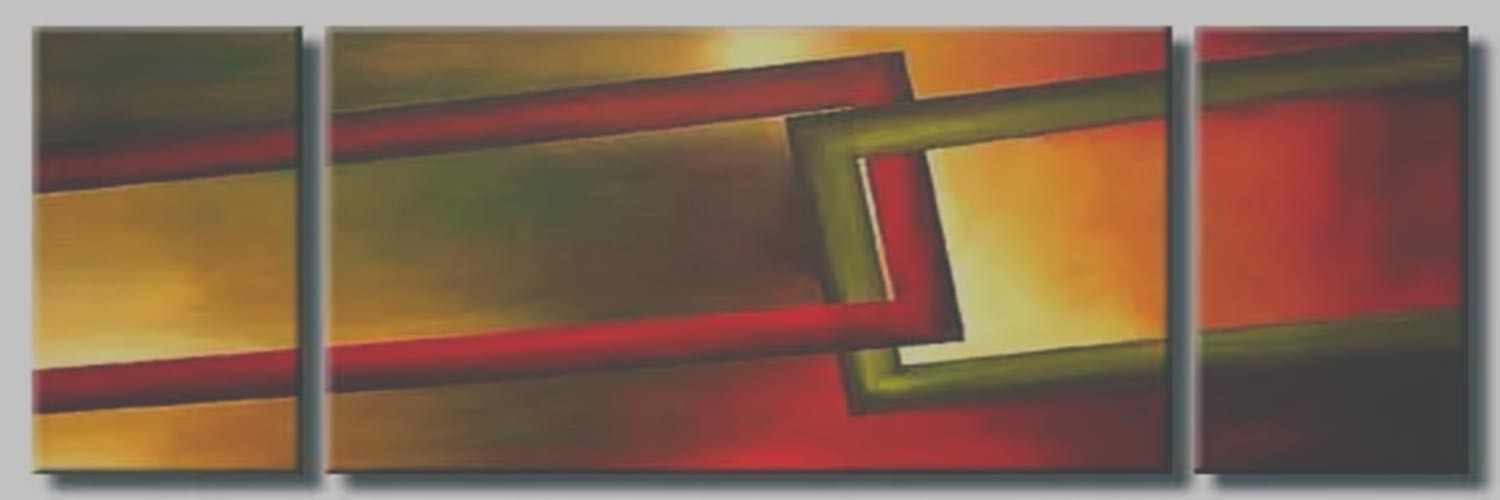






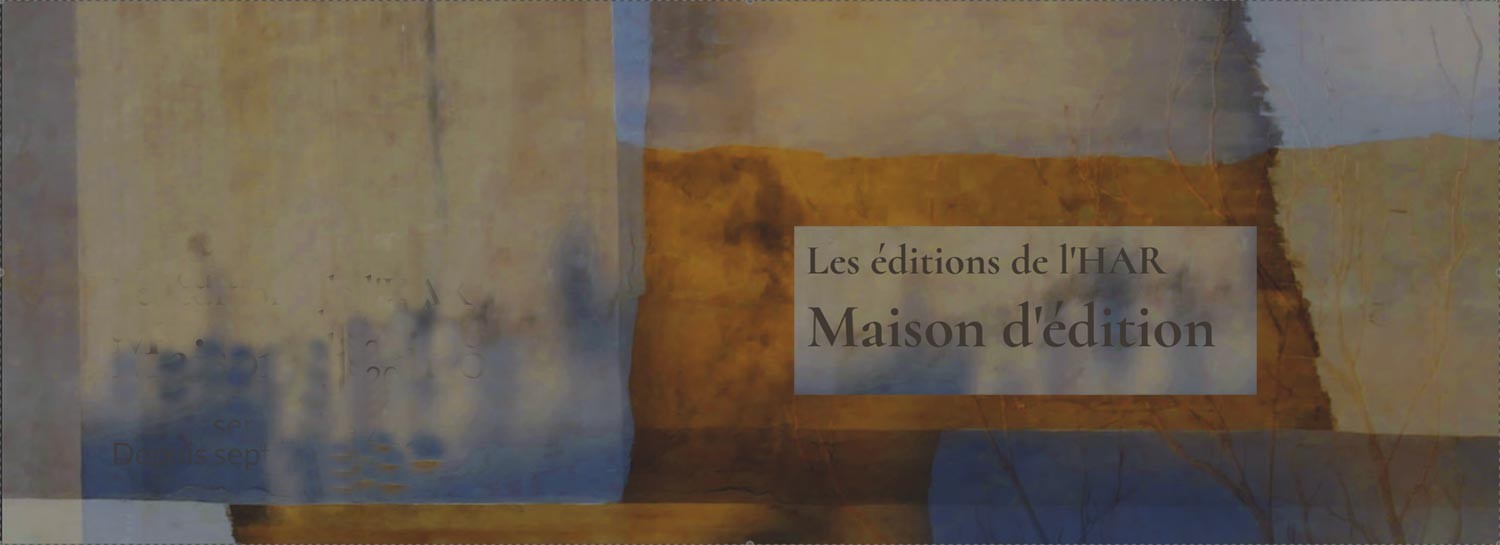
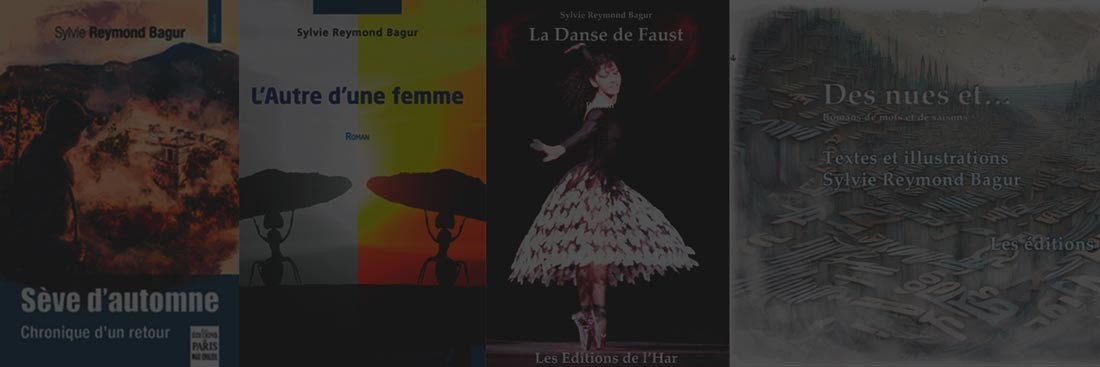
580.jpg)


